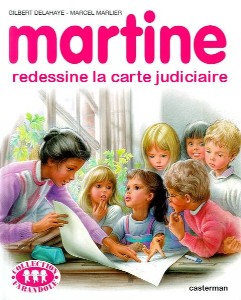Mon billet de mai 2005 sur la question
méritait depuis longtemps une mise à jour, que la
multiplication ces
derniers temps d'interventions d'avocats à
l'égard de blogueurs m'a enfin poussé
à faire.
Voyons donc ensemble le petit guide du publier tranquille, ou
comment bloguer l'âme en paix et accueillir les courriers
d'avocats avec un éclat de rire.
Écrire et publier sur un blog, c'est engager sa
responsabilité sur le contenu de ce qui y est
écrit. Et déjà apparaît le
premier problème : ce qui y est écrit
n'est pas forcément ce qu'on a écrit en tant que
taulier du blog. Certains sites y compris des blogs publient des liens
via un fil RSS (cites de type "mashup"),
c'est à dire reprennent automatiquement et sans intervention
de leur part les titres de billets ou informations parues sur d'autres
sites). Or on a vu à plusieurs reprises des sites
attaqués car de tels liens portaient atteinte à
la vie privée de personnalité susceptibles, et
ces actions ont connu un certain succès (affaire
Lespipoles.com, ou Presse-Citron, dont le
délibéré n'est pas connu au jour
où je rédige ce billet - voir plus bas).
Les commentaires font aussi partie intégrante du
blog, sauf à les interdire purement et simplement (par
exemple le blog de Pénéloppe
Jolicoeur, ou le
vénérable Standblog
(vénérable bien que je ne comprenne rien
à 90% des billets), mais dans ce cas, peut-on se demander,
est-ce encore vraiment un blog, ou à les
"modérer" selon le terme en vigueur, c'est à dire
les valider avant publication (exemple : le blog de Philippe
Bilger), ce qui est en fait une véritable censure
au sens
premier du terme : c'est à dire une autorisation a
priori. Cela peut paraître une solution de
tranquillité. Ce n'est pas si sûr que
ça, vous allez voir.
La première question que nous examinerons est celle
de la responsabilité ès qualité de
blogueur, c'est à dire de la réglementation
applicable à quiconque met son blog en ligne, quel que soit
le sujet abordé par icelui, y compris si aucun sujet n'est
abordé.
Une fois ce point examiné, nous verrons
quelle est la responsabilité en qualité
de rédacteur du blog, c'est à dire
liée au contenu de ce qui est publié. Peut-on
tout dire sur son blog, et si non, quels sont les risques ?
(Bon, je ruine le suspens d'entrée : la réponse
à la première question est non).
1. : Le statut juridique du
blog.
La réponse est dans la LCEN,
ou Loi pour la confiance dans l'économie
numérique, de son petit nom n°2004-575 du 21 juin
2004, dans son prolixe article 6 (si vous trouviez le Traité
établissant une Constitution pour l'Europe trop
longue et incompréhensible, lisez cet article 6 :
vous verrez que le législateur français peut
faire mille fois mieux).
En substance, la LCEN distingue trois types d'intervenants
dans la communication en ligne : le fournisseur
d'accès internet (FAI), qui est celui qui permet
à une personne physique ou morale d'accéder
à internet (Free, Orange, Neuf Telecom, Tele2.fr, Alice,
Noos, Numéricable sont des FAI) ; l'hébergeur du
service (celui qui possède le serveur où est
stocké le site internet) et l'éditeur du site
(qui publie, met en forme, gère le site). Alors que le FAI
et l'hébergeur sont en principe irresponsables du contenu
d'un site (il y a des exceptions, mais c'est hors sujet dans le cadre
de ce billet), c'est l'éditeur qui assume cette
responsabilité. D'où ma censure (j'assume le
terme) de certains commentaires que j'estime diffamatoires,
malgré les cris d'orfraie de leur auteur. Si le commentaire
est diffamatoire, c'est moi qui encours les poursuites, et je n'ai pas
vocation à servir de paratonnerre judiciaire à
qui que ce soit.
Exemples : Dans le cas de ce blog,
l'hébergeur est la société Typhon.com (sympa,
efficaces, compétents et chers : on dirait tout moi).
S'agissant du contenu des billets, je suis l'éditeur des
billets que je signe, et hébergeur des billets de mes
colocataires Dadouche, Gascogne et Fantômette.
Au moment de la sortie de la LCEN et de mon premier billet sur
la question, le fait de savoir si le statut d'hébergeur
serait reconnu à l'éditeur d'un site quant au
contenu qu'il ne génère pas lui-même se
posait. La jurisprudence prend bien cette direction là, et
je vais y revenir. Mais vous voyez déjà que
modérer a priori les commentaires est à double
tranchant : ce faisant, vous en devenez l'éditeur
et êtes directement responsable, et non pas en cas d'inaction
comme un hébergeur. Mais n'anticipons pas.
Pour résumer les obligations de tout blogueur, il
doit :
-déclarer son identité à son
hébergeur ou à son fournisseur d'accès
en cas d'hébergement direct par le fournisseur
d'accès (c'était le cas quand ce blog s'appelait
maitre.eolas.free.fr). Chez les hébergeurs payants, cette
formalité est assurée en même temps que
la souscription, le paiement par carte bancaire impliquant une
vérification du nom associé. Un
hébergement gratuit sous un faux nom est
désormais un délit.
Sanction : 1 an d'emprisonnement et 75.000 euros d'amende,
article 6, III, 1° et VI, 2°.
-Faire figurer sur le site le nom du responsable, ou en cas de
site non professionnel et anonyme (comme celui-ci), la mention de
l'hébergeur qui a les coordonnées du responsable,
à qui il est possible d'adresser la notification
prévue par l'article 6, I, 5° de la LCEN (voir plus
bas). C'est la rubrique "mentions légales" ; je vous
conseille tout particulièrement celle
de ma consoeur Veuve
Tarquine, qui est désopilant (bon, pour un
juriste).
Sanction : 1 an d'emprisonnement et 75.000 euros d'amende,
article 6, III, 1° et VI, 2°.
-Publier gratuitement et sous trois jours à compter
de la réception un droit de réponse de toute
personne nommée ou désignée dans un
billet ou un commentaire, sous la même forme de
caractère et de taille, sans que cette réponse ne
puisse dépasser la longueur de l'écrit initial
(sauf accord de l'éditeur, bien sûr). Dans le cas
d'une mise en cause par un commentaire, la personne en question pourra
y répondre directement par un commentaire la plupart du
temps, bien sûr.
Dans le cas d'une mise en cause dans un billet, l'éditeur
doit publier le droit de réponse sous forme d'un billet.
Sanction : 3.750 euros d'amende, article 6, IV de la LCEN.
2. la responsabilité
pénale du blogueur en raison du contenu de son site.
Là, deux problèmes distincts peuvent se
poser : la responsabilité civile du blogueur et sa
responsabilité disciplinaire. Dans le premier cas, on entre
dans le droit pénal de la presse et de l'édition,
qui s'applique à internet comme à tout
écrit mis à disposition du public, et le droit
à l'image et à l'intimité de la vie
privée. Dans le deuxième, se pose surtout la
problématique du blogueur vis à vis de son
employeur, de son école ou de son administration.
- La responsabilité pénale du
blogueur : les délits de presse.
Conseil préliminaire : si
vous êtes cité en justice pour des
délits de presse, courrez chez un avocat
compétent en la matière, et vite.
La loi française a posé par la loi du 29
juillet 1881 le principe que les délits commis par la
publication d'un message font l'objet d'un régime
procédural dérogatoire, très favorable
à la liberté d'expression. Ce régime
se résume aux points suivants :
- les faits se prescrivent par trois mois à compter de la
publication, c'est à dire que si les poursuites ne sont pas
intentées dans ce délai de trois mois, elles ne
peuvent plus l'être. De même, il faut qu'un acte de
poursuite non équivoque ait lieu au moins tous les trois
mois, sinon, la prescription est acquise.
- les poursuites des délits portant atteinte à
l'honneur d'une personne ne peuvent avoir lieu que sur plainte de la
personne concernée, et le retrait de la palinte met fin aux
poursuites, ce qui n'est pas le cas d'une plainte ordinaire, pour un
faux SMS par exemple.
- les actes de poursuites doivent respecter des règles de
forme très strictes sanctionnées par leur
nullité (or un acte nul n'interrompt pas la prescription,
vous voyez la conséquence inéluctable...).
- des moyens de défense spécifiques existent dans
certains cas (excuse de vérité des faits, excuse
de bonne foi, excuse de provocation)...
Certains écrits sont donc pénalement
incriminés en eux même : la
liberté d'expression est une liberté
fondamentale, certes, mais il n'existe aucune liberté
générale et absolue. Rappelons la
rédaction de l'article 11 de la déclaration des
droits de l'homme et du citoyen :
La libre communication des pensées et des
opinions est un des droits les plus précieux de
l'Homme : tout Citoyen peut donc parler, écrire,
imprimer librement, sauf à répondre à
l'abus de cette liberté dans les cas
déterminés par la Loi.
En l'espèce, la loi qui s'applique est notre loi du
29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, avec les
adaptations apportées par la LCEN aux
spécificités du support informatique. Qu'est-ce
qui est interdit, au juste ?
Sont interdits de manière
générale l’apologie des crimes contre
l’humanité commis par les puissances de l'Axe
(n'allez pas approuver la prostitution forcée des femmes
coréennes par l'armée impériale
japonaise, mais vous pouvez vous réjouir de la famine
provoquée par Staline en Ukraine et ses 3 à 7
millions de mort), l’incitation à la haine raciale
ainsi que la pornographie enfantine. Tout blogueur a comme n'importe
quel éditeur une obligation de surveillance de son
site et doit rapporter promptement aux autorités
compétentes de telles activités sur son site qui
lui seraient signalées.
Sanction : un an de prison, 75.000 euros d'amende (article I,
7°, dernier alinéa de la LCEN, article 24 de la loi
du 29 juillet 1881). Pensez donc absolument à fermer tous
les commentaires et trackbacks quand vous fermez un blog
mais laissez les archives en ligne.
Au delà de cette obligation de surveillance, les
écrits du blogueur lui même ou des commentaires
peuvent lui attirer des ennuis.
- Les provocations aux infractions.
Outre les faits déjà cités,
sont prohibés la provocation à commettre des
crimes ou des délits. Si appeler au meurtre ne viendrait pas
à l'esprit de mes lecteurs, j'en suis persuadé,
pensons aux appels à la détérioration
des anti-pubs (affaire
"OUVATON").
Sanction : si la provocation est suivie d'effet, vous
êtes complice du crime ou délit et passible des
mêmes peines. Si la provocation n'est pas suivie d'effet,
vous encourez 5 ans de prison et 45.000 euros d'amende si l'infraction
à laquelle vous avez provoqué figure dans la
liste de l'alinéa 1 de l'article 24 de la loi du 29 juillet
1881 (meurtres, viols et agressions sexuelles, vols, extorsions,
destructions, dégradations et
détériorations volontaires dangereuses pour les
personnes, crimes et délits portant atteinte aux
intérêts fondamentaux de la nation
prévus par le titre Ier du livre IV du code
pénal).
Bon, jusque là, rien de préoccupant, je
pense qu'on peut trouver des idées de billet où
il ne s'agira pas de nier la Shoah ou appeler au meurtre.
Les faits les plus souvent invoqués sont l'injure
et la diffamation, définis par l'article 29 de la loi du 29
juillet 1881. C'est le cas de l'affaire Monputeaux, que j'ai
traitée en son temps.
Là, ça se complique. Je vais donc, pour
illustrer mes propos, prendre un cobaye en la personne de Laurent
Gloaguen dont la bonhomie bretonne ne doit pas faire oublier un
tempérament potentiellement tempétueux.
La diffamation, donc, est définie ainsi :
toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte
à l'honneur ou à la considération de
la personne ou du corps auquel le fait est imputé.
e.g. : "Laurent Gloaguen est un escroc".
L'injure est toute expression outrageante ne contenant
l'imputation d'aucun fait.
e.g. : "Laurent Gloaguen est un connard".
Tout d'abord, il faut que la personne soit
identifiée ou au moins identifiable. Inutile qu'il soit
identifiable par des milliers de personnes. Un groupe restreint suffit,
du moment qu'il peut subir un préjudice du fait
d'être reconnu par ce groupe comme le milieu professionnel
dans lequel il évolue (par exemple : un chercheur
dénoncé auprès de la direction du CNRS
comme étant un terroriste international, mais là
j'exagère avec mes exemples : personne ne serait
assez stupide et méchant pour oser faire une chose pareille).
Si le blogueur dit "Laurent Gloaguen est un escroc", il n'y a
pas de problème, il est clairement identifié.
S'il dit "le soi-disant capitaine qui nous inflige ses embruns
sur internet est un escroc", il n'est pas nommé, mais reste
aisément identifiable. Le blogueur ne peut pas
prétendre devant le tribunal qu'en fait, il parlait de
quelqu'un d'autre, sauf à expliquer de qui.
Un problème peut apparaître face
à des expressions plus ambiguës, du genre "le
blogeur influent qui n'aime pas les chatons", ou l'emploi des seules
initiales ("Ce crétin de LG...") . Dans ce cas, c'est au
plaignant d'apporter la preuve que c'est bien lui qui était
visé, les tribunaux allant parfois jusqu'à
exiger, pour les cas vraiment ambigus, la preuve que le plaignant a
été identifié comme la personne
visée par des lecteurs.
Une fois que la personne visée est
identifiée, le propos diffamatoire doit lui imputer un fait
qui porte atteinte à son honneur ou à sa
considération. Le critère jurisprudentiel est
simple : le fait diffamatoire doit pouvoir faire l'objet d'une
discussion contradictoire et être prouvé.
Sinon, c'est une injure.
Dans mon exemple, dire que "Laurent Gloaguen est un escroc"
est une diffamation, puisqu'on lui impute un délit,
susceptible de preuve, et le fait d'être traité de
délinquant porte atteinte à l'honneur ou
à la considération.
En cas de poursuite judiciaires, les moyens de
défense sont les suivants :
- A tout seigneur tout honneur : la prescription.
Aucune poursuite ne peut être intentée pour injure
ou diffamation trois mois après la publication. Seule peut
interrompre cette prescription un acte de poursuite
judiciaire : assignation au civil, citation au
pénal, tenue d'une audience où
comparaît le plaignant. Concrètement, à
Paris, la 17e chambre, spécialisée dans ces
domaines, convoque des audiences-relais à moins de trois
mois, uniquement pour que la partie civile comparaisse et indique
qu'elle maintient les poursuites, jusqu'à la date retenue
pour l'audience définitive. Une lettre de mise en demeure,
émanât-elle d'un avocat, n'interrompt pas la
prescription. La preuve de la date de publication est libre, la
jurisprudence recevant comme présomption simple la mention
de la date à côté du billet.
L'idéal est de recourir au constat d'huissier, car c'est au
plaignant de rapporter la preuve, en cas de litige, que la prescription
n'est pas acquise. C'est TRES casse gueule : si vous voulez
poursuivre quelqu'un pour diffamation, prenez un avocat, vous n'y
arriverez pas tout seul.
- Démontrer que le plaignant n'était pas
visé par les propos, car seule la personne visée
peut déclencher les poursuites ;
- Démontrer que les propos ne sont pas
diffamatoires, ou injurieux, voire, et là c'est vicieux, que
les propos diffamatoires sont en fait injurieux, ou vice versa, car
aucune requalification n'est possible, et on ne peut poursuivre sous
les deux qualifications cumulativement.
En effet, imaginons qu'un blogueur traite dans un de ses
billets Laurent Gloaguen d'escroc, le 1er janvier (prescription au 1er
avril). Laurent Gloaguen fait citer en diffamation ce blogueur le 1er
février (interruption de la prescription, elle est
reportée au 1er mai, en fait au 2 puisque le 1er est
férié). Le tribunal convoque les parties le 1er
mars (cette audience interrompt la prescription, le délai de
trois mois repart à zéro, et elle est donc
reportée au 1er juin), et fixe l'audience de jugement au 1er
mai (soit bien avant la prescription, tout va bien). Le 1er mai, le
blogueur soulève qu'il ne s'agissait pas d'une accusation
d'escroquerie, mais juste d'une moquerie sur le fait qu'en fait,
Laurent Gloaguen adorerait les chatons : c'était donc en
fait une injure. Or l'injure n'a pas été
poursuivie dans le délai de trois mois qui expirait le 1er
avril et est donc prescrite Si le tribunal estime que
c'était effectivement une injure, le blogueur est
relaxé.
Vous comprenez pourquoi il vous faut absolument un
avocat ?
- La bonne foi et l'exception de vérité.
Ces exceptions (c'est ainsi qu'en droit on appelle un moyen de
défense visant au débouté du
demandeur) ne s'appliquent qu'aux poursuites pour diffamation.
L'exception de vérité est soumise à de
strictes conditions de formes (délai de dix jours pour
signifier les preuves par huissier à compter de la
citation ou de l'assignation) et de domaines (il existe des faits dont
la loi interdit de tenter de rapporter la preuve : lorsque l'imputation
concerne la vie privée de la personne ; lorsque l'imputation
se réfère à des faits qui remontent
à plus de dix années ou lorsque l'imputation se
réfère à un fait constituant une
infraction amnistiée ou prescrite, ou qui a donné
lieu à une
condamnation effacée par la réhabilitation ou la
révision). L'exception de bonne foi est plus large dans son
domaine,
mais la preuve de la bonne foi pèse sur le
prévenu. Le prévenu doit, pour en
bénéficier, établir, selon la formule
jurisprudentielle classique, qu’il poursuivait, en diffusant
les propos incriminés, un but
légitime exclusif de toute animosité personnelle,
qu’il a conservé dans
l’expression une suffisante prudence et qu’il avait
en sa possession
des éléments lui permettant de
s’exprimer comme il l’a fait. L'exception de bonne
foi permet aux juges d'atténuer
la sévérité des
règles de la preuve de la vérité des
faits si le diffamateur a agi légitimement et avec
prudence (par exemple, il a dénoncé un candidat
à des élections au sujet de faits graves commis
plus de dix ans auparavant mais qui le rendent peu qualifié
pour être élu : Cass. crim., 15
févr. 1962).
- L'excuse de provocation.Cette excuse ne s'applique qu'à
l'injure contre un particulier. Si celui qui a injurié l'a
fait à la suite de provocations
(généralement, une injure préalable),
le délit n'est pas constitué, celui qui agonit
son prochain étant malvenu à être
susceptible.
La diffamation et l'injure sont punies d'amendes pouvant
aller jusqu'à 12 000 euros. Elles peuvent porter sur une
personne, ou sur un corps (ex : la police). Quand elles portent
sur les tribunaux, les armées de terre, de mer ou
de l'air, les corps constitués et les administrations
publiques, ou à raison de leurs fonctions ou de leur
qualité, envers un ou
plusieurs membres du ministère, un ou plusieurs
parlementaires, un fonctionnaire
public, un dépositaire ou agent de l'autorité
publique, un citoyen chargé d'un service ou
d'un mandat public temporaire ou permanent, un juré ou un
témoin, à
raison de sa déposition, l'amende est portée
à 45 000 euros.
Constituent des cas à part, plus
sévèrement réprimés, les
injures et diffamation à caractère racial, ce mot
étant utilisé
brevitatis causa
à la place de l'expression exacte "
à raison de leur
origine ou de leur appartenance ou de leur
non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une
religion
déterminée,ou à raison de leur sexe,
de leur orientation sexuelle
ou de leur handicap."
- Le blogeur et la discipline professionnelle
Voyons à présent
l'hypothèse où aucun délit n'a
été commis, mais où une personne
exerçant une autorité (supérieur
hiérarchique, employeur, professeur) s'émeut de ce
que publie le blogueur et s'avise de le sanctionner. Ce qu'un blogueur
écrit, que ce soit de chez lui, en dehors des heures qu'il
doit consacrer à son activité professionnelle ou
scolaire, ou depuis son lieu de travail, peut-il entraîner
une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement, la
révocation ou le renvoi de
l'établissement ?
Beaucoup de blogueurs, croyant à leur
impunité, s'y sont frottés à la
légère, et s'y sont brûlés
les ailes. Les premiers exemples sont venus d'outre atlantique avec par
exemple Queenofsky, hôtesse de
l'air chez Delta Airlines licenciée pour avoir posté
des photos d'elle en uniforme de la compagnie, mais des
Français aussi
ont eu des mauvaises surprises. Dans le milieu du travail, c'est bien
sûr l'affaire Petite Anglaise, dont
j'ai
déjà parlé. Dans le milieu
de la
fonction publique, c'est l'affaire
Garfieldd. Dans les deux cas, les
choses se sont bien terminées pour les blogueurs,
très bien même pour Petite Anglaise qui a
commencé une carrière d'écrivain.
S'agissant des élèves, je me souviens d'avoir
entendu parler d'élèves renvoyés de
leur établissement pour des propos tenus sur leur blog, mais
dont le renvoi a été annulé par le
tribunal administratif. je n'ai pas réussi à en
retrouver la trace. Si quelqu'un avait des infos, je lui en saurai
gré et compléterai ce billet.
Face à la nouveauté du
phénomène, autant des blogueurs
dépassent les bornes sans forcément en avoir
conscience, autant des employeurs prennent des sanctions parfois
discutables.
Alors qu'en est-il ? Le principe est que la
sphère privée est séparée
de la sphère professionnelle (qui inclut la
sphère scolaire). Aucun salarié ou
élève ne peut en principe être puni
pour un comportement qu'il a dans sa vie privée ou en dehors
de ses heures de travail ou d'étude.
Certaines professions font exception à cette
règle, à commencer par la mienne, et
de manière générale tous les
fonctionnaires. Mais les membres de ces professions sont
généralement bien informés de leurs
obligations déontologiques. Ces obligations varient
d'ailleurs tellement d'une profession à l'autre que je n'en
ferai point le recensement. Le point commun aux fonctionnaires le
fameux devoir de réserve (dont le pourtour est assez flou ;
disons de manière générale de ne pas
donner son opinion personnelle sur le travail qu'il lui est
demandé d'effectuer), l'obligation de
loyauté, de
neutralité, et
l'obligation au respect du secret professionnel.
Mais la séparation sphères
privée et publique n'est pas parfaitement
étanche. Ainsi en est il lorsque le blogueur parle de son
travail sur son blog. Là commence le danger.
S'agissant des fonctionnaires, l'attitude varie totalement d'un
ministère à l'autre, à un point tel
que cela pose de sérieuses questions en matière
d'égalité des droits. Et cela ne s'explique pas
par la spécificité des missions : alors que le
ministère de l'intérieur fiche une paix royale
aux policiers blogueurs, le ministère de
l'éducation nationale semble très hostile
à l'idée que des enseignants puissent raconter
leur métier. En l'espèce, il ne fait aucun doute
à mes yeux que c'est le ministère de
l'intérieur qui a raison, tant le travail
bénévole de ces blogueurs est
bénéfique en termes d'image (voyez dans ma
blogroll à droite pour quelques exemples de
qualité).
S'agissant des salariés, la situation est plus claire.
Juriscom.net
rappelle que le principe posé dans un
arrêt du 16 décembre 1998 est que le
comportement du salarié dans sa vie privé ne
justifie pas de sanction disciplinaire, sauf si ce comportement cause
un trouble caractérisé dans l'entreprise. Le mot caractérisé
est important : ce trouble n'est pas laissé
à l'appréciation de l'employeur, qui doit
justifier sa décision de sanction fondée sur ce
trouble et le cas échéant en apporter la preuve
devant le juge si la sanction est contestée.
Rappelons également que le salarié, qui
est lié contractuellement à son employeur, a
à l'égard de celui-ci une obligation de
loyauté, qui rendrait fautif tout dénigrement et
critique virulente publics même en dehors des heures de
travail.
L'affaire Petite Anglaise a conduit le Conseil de prud'hommes de Paris
à rendre
une
décision posant clairement le cadre
de la compatibilité du blogage et du travail. Cela reste un
jugement, car il n'a pas été frappé
d'appel, mais je pense que les principes qu'il pose auraient
été confirmés en appel et quela cour
de cassation n'y aurait rien trouvé à redire.
Pour mémoire, cette décision considère
qu'un salarié peut parler de son travail
sur son blog, même en termes critiques, à la
condition que son
employeur ne soit pas identifiable. A contrario, on peut en
déduire que
s'il l'était, le Conseil pourrait considérer
qu'il y a une cause réelle
et sérieuse,
si les propos nuisent
à l'entreprise, notamment en étant
diffamatoires ou injurieux.
Il peut de même bloguer depuis son poste de travail
avec le matériel de
l'entreprise s'il ne nuit pas à l'employeur en ce
faisant : c'est à
dire sans le faire passer avant son travail, et dans le respect du
règlement intérieur. Donc : sur ses
temps de pause, ou dans les phases
d'inactivité.
Pour en savoir plus, mon confrère Stéphane Boudin
a
abordé ce sujet en profondeur.
Enfin, rappelons un point essentiel : un
licenciement, même qualifié d'abusif par le
Conseil des prud'hommes, reste définitif. Donc si votre
employeur vous vire à cause de votre blog bien que vous
n'ayez jamais franchi les limites de la légalité,
vous recevrez une indemnité, mais vous resterez
chômeur. Soyez donc très prudents et tournez sept
fois votre souris dans votre main avant de poster. Les fonctionnaires
sont mieux lotis car une révocation annulée
implique la réintégration immédiate du
fonctionnaire. Enfin, immédiate... le temps que le tribunal
administratif statue, ce qui est de plus en plus long (comptez
facilement deux ans pour un jugement).
Dernier terrain sensible : la question de la vie
privée. L'article 9 du code civil pose le principe du droit
de chacun au respect de sa vie privée et donne au juge des
référés le pouvoir de prendre les
mesures nécessaires pour mettre fin à une telle
violation. Il en va de même de son droit à
l'image, c'est à dire la diffusion d'un portrait de lui pris
sans son consentement. Il faut bien comprendre ce qu'on entend par vie
privée : la jurisprudence parle même de l'intimité de la vie
privée. Il s'agit donc d'aspects que la
personne n'a jamais voulu voir divulgués portant sur la
sphère privée : les sphère
professionnelles et publiques (pour ceux qui font profession
d'être connus, comme les acteurs et les hommes politiques)
sont donc exclues.
Cela recouvre la vie de famille (relations
sentimentales, enfants), la vie sexuelle (moeurs, orientation
sexuelle), etc... Ne parlez pas de la vie
privée d'une personne dénommée ou
aisément identifiable (mêmes règles que
pour la diffamation) sans son autorisation, fût-ce un membre
de l'étrange tribu des "pipoles" dont la vie
privée est censée passionner jusqu'au dernier
occupant des salles d'attente et salons de coiffure de
l'hexagone. Ne diffusez pas non plus son image, ni le son de sa voix
sans son autorisation. Le fait qu'une personne se rende dans un lieu
public peut faire présumer son acceptation d'être
prise en photo (sauf s'il esquive votre flash, auquel cas il ne vous
reste qu'à ne pas insister) mais certainement pas que cette
photo soit diffusée sur internet. Cette simple diffusion est
en soi un préjudice réparable, sans
qu'il soit besoin de démontrer un
préjudice, et les sommes allouées sont assez
élevées si lapersonne a une certaine
notoriété. Je précise que
capter l'image d'une personne dans un lieu privé ou la voix
de quelqu'un parlant à titre privé ou
confidentiel sans son consentement est un délit
pénal.
Un mot d'explication pour comprendre. Une évolution
récente de la société a
créé une nouvelle sorte d'aristocratie, les gens
ayant une certaine notoriété. Les ragots les
concernant sont affublés de mots anglais pour devenir du
dernier chic, et les news
people se vendent fort bien. Mais c'est un biotope
économique délicat, et qui réagit
violemment aux incursions de parasites espérant entrer dans
ce monde sans mettre la main à la poche. Car être people, c'est un
métier. En Espagne, par exemple, c'est une vraie profession.
De nombreux magazines relatent leurs aventures, avec la complaisance
d'iceux, et même la télévision publique
consacre des émissions sur le sujet (ce qui explique aussi
sans doute que la radio-télévision publique
espagnole fasse des bénéfices). En France, on est
plus hypocrite. Des journaux faisant fonds de commerce de
publier des images et des articles sans leur consentement sont
condamnés à payer des
dommages-intérêts qui constituent une
rémunération non imposable. Bref, les peoples vivent de
leur état. Donc tenter de profiter de
l'intérêt (comprendre de l'audience) que cela
génère sans être prêt
à payer l'octroi amènera à
des mauvaises surprises.
Et la jurisprudence est plutôt favorables auxdits peoples, comme le
montre l'affaire Lespipoles.com.
Ce site est principalement un amas de
publicités et une agrégation de liens vers des
sites de journaux se consacrant à ce noble sujet. Or un
jour, un de
ces liens reprenait une nouvelle publiée par un journal
réputé en matière de cancans qui
annonçait que tel réalisateur français
récemment honoré outre-atlantique roucoulerait
avec une actrice devenue célèbre en croisant les
jambes à l'écran. Ledit réalisateur a
poursuivi en
référé le site (en fait le titulaire
du nom de domaine) pour atteinte
à sa vie privée.
L'intéressé s'est défendu
en faisant valoir qu'il n'avait pas lui même mis en ligne
l'information, puisqu'elle n'était apparue qu'en tant que
figurant dans le fil RSS du journal. Bref, vous aurez compris, qu'il
n'était qu'hébergeur et non éditeur de
l'information litigieuse. Le juge des
référés de Nanterre a
rejeté cet argument en estimant que la
partie défenderesse avait bien, en
s’abonnant
audit flux et en
l’agençant selon une disposition
précise et préétablie, la
qualité
d’éditeur et devait en assumer les
responsabilités, et ce à raison des
informations qui figurent sur son propre site.
Cette
décision a un autre enseignement : c'est l'importance des
mentions légales. Dans cette affaire, c'est la personne
physique ayant enregistré le nom de domaine qui a
été poursuivie et condamnée car le
site ne mentionnait pas le nom de la société
commerciale qui
l'exploitait et qui était la véritable
responsable. En revanche, quand ces mentions existent, les poursuites
contre le titulaire du nom de domaine sont irrecevables : c'est l'affaire
Wikio, par le même juge des
référés (le même magistrat
s'entend), et accessoirement le même demandeur.
C'est sur cette jurisprudence que se fonde
l'affaire Olivier Martinez,
du nom de l'acteur qui a décidé de poursuivre
toute une série de sites ayant relayé une
information sur une relation sentimentale réelle ou
supposée. Je ne jurerai pas que le rapprochement
chronologique des deux affaires soit purement fortuit.
Pour le moment, il est trop tôt pour dire si ces
décisions auront une grande portée ou seront
contredites par l'évolution de la jurisprudence.
Dernier point pour conclure ce billet : celui de la
contrefaçon. La contrefaçon est à la
propriété intellectuelle et artistique ce que le
vol est à la propriété corporelle :
une atteinte illégitime. Et elle est d'une
facilité déconcertante sur internet. Un simple
copier coller, voire un
hotlink
sur le cache de Google pour économiser la bande passante. La
contrefaçon peut concerner deux hypothèses : la
contrefaon d'une oeuvre (on parle de propriété
littéraire et artistique, même si un logiciel est
assimilé à une oeuvre) ou la
contrefaçon d'une marque ou d'un logo (on parle de
propriété industrielle) consiste en la
reproduction ou la
représentation d'une oeuvre de l'esprit ou d'une marque sans
l'autorisation
de celui qui est titulaire des droits d'auteur, que ce soit l'auteur
lui-même ou un ayant droit (ses héritiers, une
société de gestion collective des droits du type
de la SACEM...). La reproduction est une copie de l'oeuvre, une
représentation est une exposition au public. L'informatique
fait que la plupart du temps, la contrefaçon sera une
reproduction.
Le régime diffère selon qu'il s'agit
d'une oeuvre ou d'une marque.
- Pour une oeuvre, la protection ne nécessite aucune
démarche préalable de dépôt
légal de l'oeuvre. L'acte de création
entraîne la protection. Et la simple reproduction constitue
la contrefaçon. Par exemple, copier ce billet et le publier
intégralement sur votre blog serait une
contrefaçon, même via le flux RSS. De
même, utiliser une image d'une graphiste comme
Cali
Rézo ou
Pénéloppe
Jolicoeur
sans son autorisation est une contrefaçon.
Et la contrefaçon est un délit, passible de 3
années de prison et jusqu'à 300 000 euros
d'amende. Outre les dommages-intérêts à
l'auteur. Et la prescription de trois mois ne s'applique pas ici : elle
est de trois ans. Il ne s'agit pas d'un délit de presse, qui
ne concerne que les oeuvres que vous publiez, pas celles que vous
pompez.
Cependant, il existe des exceptions : la loi (
article
L.122-5 du code de la propriété intellectuelle)
permet d'utiliser une oeuvre
divulguée, et ce sans l'autorisation de l'auteur, soit pour
votre usage strictement privé (i.e. sauvegarde sur votre
disque dur) mais sans la diffuser à votre tour, ou en cas de
publication, en respectant l'obligation de nommer son auteur et les
références de l'oeuvre, dans les
hypothèses suivantes : les analyses et courtes citations
justifiées par le caractère
critique, polémique, pédagogique, scientifique ou
d'information de
l'oeuvre à laquelle elles sont incorporées (en
clair, si quelqu'un veut critiquer un de mes billets, il peut sans me
demander mon avis citer les passages clefs qui lui semblent
démontrer l'inanité de mon propos) ;
les revues de
presse ; la diffusion, même intégrale,
à titre
d'information
d'actualité, des discours destinés
au public prononcés dans les assemblées
politiques, administratives,
judiciaires ou académiques, ainsi que dans les
réunions publiques
d'ordre politique et les cérémonies officielles ;
la parodie et le pastiche en respectant les lois du genre, et
la
reproduction ou la représentation, intégrale ou
partielle, d'une
oeuvre d'art graphique, plastique ou architecturale, dans un but
exclusif d'information
immédiate et en relation directe avec cette
dernière,
sous réserve
d'indiquer clairement le nom de l'auteur.
Par contre, piquer un dessin ou une photo trouvée sur Google
qui
vous plaît parce qu'elle illustre bien votre article qui n'a
rien
à voir avec l'oeuvre risque fort de vous attirer des ennuis,
surtout si l'oeuvre est celle d'un professionnel. Il existe de nombreux
répertoires d'images et photos libres de droits ou mises
à votre disposition gratuitement sous réserve que
vous
respectiez certaines conditions dans l'usage : ce sont les oeuvres en
partage, ou
Creative Commons en
bon français.
- Pour une marque, la logique est différente, car c'est
l'intérêt économique du titulaire de la
marque qui est défendu. La loi le protège
d'agissements parasites de concurrents qui voudraient utiliser un
élément distinctif pour vendre leur produit. En
effet, faire de telle marque, telle couleur, tel logo un signe
distinctif dans l'esprit du public est un travail de longue haleine, et
très coûteux. Il est légitime que celui
qui aura déployé tous ces moyens puisse s'assurer
le monopole des bénéfices à en tirer.
La marque Nike par exemple, dans les magasins qu'elle ouvre, se
contente de mettre sa célèbre virgule comme seule
enseigne. Songez aussi tout ce que représente pour les
informaticiens la petite pomme grise et croquée. La
protection de la marque suppose toutefois au préalable le
dépôt de cette marque auprès de
l'Institut National de la
Propriété Industrielle,
dépôt qui précisera les types de
produits sur lesquels il porte (on parle de classes de produits,
en
voici la liste). D'où l'expression de "marque
déposée". Dans les pays Anglo-Saxons, l'usage est
d'apposer après une telle marque un ® qui signfie
registered,
"enregistré".
La loi interdit, sauf autorisation de l'auteur : la reproduction,
l'usage ou l'apposition d'une marque, même avec
l'adjonction de mots tels que : "formule, façon,
système, imitation,
genre, méthode" (Exemple : "
le blog façon Techcrunch",
Techcrunch étant une marque déposée au
niveau européen), ainsi que l'usage d'une marque reproduite,
pour des
produits ou services identiques à ceux
désignés dans l'enregistrement ; la suppression
ou la modification d'une marque régulièrement
apposée.
De même, la loi interdit, mais uniquement s'il peut en
résulter un risque de confusion dans l'esprit du public : la
reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, ainsi
que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services
similaires à ceux désignés dans
l'enregistrement ; ainsi que l'imitation d'une marque et l'usage d'une
marque imitée,
pour des produits ou services identiques ou similaires à
ceux désignés
dans l'enregistrement. (
Code
de la propriété intellectuelle, articles L.713-2
et L.713-4).
Mes lecteurs se souviendront qu'une marque peut être une
simple couleur, avec
l'affaire
Milka, qui ne concerne pas un blogueur mais un nom de
domaine, donc n'est pas totalement étranger à nos
interrogations. En ce qui concerne votre humble serviteur, Eolas est
une marque déposée... mais pas par moi. Je
suppose qu'elle appartient à la
société
Business
& Decision Interactive Eolas, qui m'a toujours fichu
une paix royale quant à l'usage de mon pseudonyme puisqu'il
n'y a aucun risque de confusion quand bien même je
sévis moi aussi sur l'internet. Nous vivons donc en bons
voisins. Enfin, je suppose : je n'ai jamais eu de contact avec eux, je
déduis de leur silence une intelligente bienveillance.
Voici dressé un panorama que je n'aurai pas
l'audace de prétendre
exhaustif des limites fixées par la loi que doit respecter
un blogueur.
Vous voyez que les espaces de liberté sont encore vastes.
Cependant, il peut arriver que des fâcheux estiment que
ceux-ci sont encore trop vastes, et que parler d'eux en des termes qui
ne soient pas dythirambiques relève du crime de
Lèse
Majesté. Et parfois, le blogueur reçoit un e-mail
ou
mieux, une lettre recommandée
particulièrement comminatoire rédigée
par un de
mes confrères. Et je dois le reconnaître, bien que
cela me
coûte, pas toujours à très bon escient,
voire
parfois à un escient franchement mauvais. Et j'ai trop de
respect pour ma profession pour me rendre complice par inaction de
cette pratique hélas de plus en plus répandue et
qui
prend des libertés avec la loi et avec la
déontologie. Un
guide de survie s'impose.
Ce sera l'objet du deuxième billet qui fera suite
à celui-ci : que faire en cas de mise en demeure ?

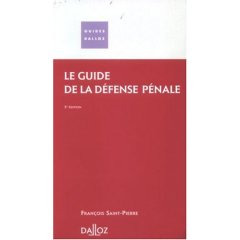 Le second s'adresse plus spécifiquement aux avocats. Il s'agit du
Le second s'adresse plus spécifiquement aux avocats. Il s'agit du 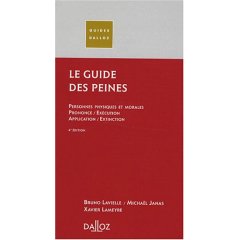 Enfin, le troisième, lui, s'adresse plus aux magistrats, mais devrait intéresser aussi les avocats pénalistes. Il s'agit du
Enfin, le troisième, lui, s'adresse plus aux magistrats, mais devrait intéresser aussi les avocats pénalistes. Il s'agit du