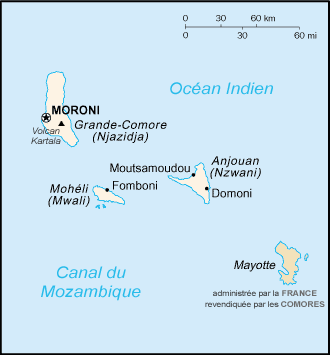Je veux croire qu'il y a une erreur. Un malentendu. Un élément que j'ignore. J'espère de tout cœur que Rue 89 se trompe. Car sinon, le scandale est à hurler de rage.
Rue 89 rapporte que le premier président[1] de la cour d'appel de Toulouse a condamné un étranger qui faisait appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant prolongé son placement en rétention administrative.
Rappelons ici le processus de la reconduite à la frontière d'un étranger en situation irrégulière.
L'étranger est interpellé par la police, soit lors d'un contrôle d'identité, soit à l'occasion d'une enquête sur une infraction. La police constate sa situation irrégulière (il ne peut présenter de titre de séjour), et après une vérification sur le FPR (Fichier des Personnes Recherchées) pour s'assurer qu'il ne fait pas déjà l'objet d'une décision exécutoire d'éloignement, est placé en garde à vue pour séjour irrégulier. Le procureur valide la mesure, sachant qu'il ne verra jamais l'étranger. Il s'agit juste de laisser le temps à la préfecture soit de prendre un arrêté de reconduite à la frontière, soit de retrouver l'acte d'éloignement en vigueur. Quand tout est prêt, la préfecture (qu'on appelle pour la circonstance "le pôle de compétence", pour ne pas dire qu'il y a collaboration entre les autorités administratives et judiciaires, en France, c'est sale) notifie l'acte si besoin et prend un arrêté de placement en centre de rétention administrative pour 48 heures[2]. Le parquet met fin à la garde à vue et classe sans suite la procédure pour séjour irrégulier.
Au bout de 48 heures, la prolongation du placement, qui ne pourra avoir lieu qu'en Centre de Rétention Administrative (CRA), ne peut être ordonné que par un juge judiciaire, gardien des libertés individuelles. C'est la Constitution. Ce rôle est dévolu depuis 2001 au juge des libertés et de la détention. Ce sont les audiences dites « 35bis » du numéro de l'article de l'ordonnance du 2 novembre 1945 qui prévoyait cette procédure. Aujourd'hui, c'est devenu l'article L.551-1 du CESEDA mais le nom 35bis est resté (les panneaux des tribunaux n'ont pas été changés d'ailleurs). Cette prolongation est d'une durée maximale de 15 jours et peut être renouvelée une fois, pour un total de 32 jours de privation de liberté.
Le rôle du JLD est de vérifier la légalité de la procédure, car il y a privation de liberté par l'administration d'une personne qui n'est pas condamnée ni même poursuivie, puis d'envisager le cas échéant si l'étranger ne peut pas faire, “ exceptionnellement ” dit la loi, l'objet d'une assignation à résidence plutôt qu'être enfermée dans un CRA. Oui, quand on est étranger, la liberté est l'exception, même si on n'est ni condamné ni même poursuivi. Le Conseil constitutionnel, pour valider ce dispositif, a exigé que l'étranger puisse même à tout moment saisir le JLD (considérant 66) pour demander qu'il soit mis fin à sa rétention, précisant que le juge exerce sur cette mesure un contrôle d'opportunité en droit et en fait. C'est peu dire que ce contrôle d'opportunité n'est pas mené avec un grand enthousiasme par les JLD. À leur décharge, ils sont rarement saisis de la question par les avocats. Mais tout comme une personne en détention provisoire peut demander à tout moment sa remise en liberté, l'étranger en rétention doit pouvoir contester la mesure dont il fait l'objet.
Dans notre affaire, l'étranger a semble-t-il contesté devant le JLD la légalité de la procédure au stade de la garde à vue : son droit à l'assistance d'un avocat ne lui aurait pas été correctement notifié. S'il est fondé, c'est un moyen de nature à annuler toute la procédure, et à conduire à sa remise en liberté immédiate. Le JLD l'a estimé non fondé et a ordonné la prolongation de la détention.
L'étranger peut faire appel de cette décision dans les 24 heures (même le dimanche, même le jour de noël, c'est 24 heures et pas une minute de plus) par une requête, écrite, en français, et qui doit être motivée, c'est à dire expliquer les raisons de cet appel. L'appel est alors jugé par le premier président de la cour d'appel (PPCA) dans les 48 heures (art. L. 552-9 du CESEDA). Pour les mêmes raisons qu'expliquées plus haut, cette audience est encore appelée « 22ter » par les avocats et magistrats.
Mais l'étrangeté de cette procédure est que, même si l'intéressé est privé de liberté, arrivé menotté et escorté à l'audience, et que tous les débats portent sur des articles du code de procédure pénale, cette procédure est de nature civile. C'est ce qu'a jugé la cour de cassation. On peut la comprendre : l'étranger n'est pas accusé d'un quelconque délit. La conséquence est que, hors des règles établies par le CESEDA, c'est le Code de procédure civile qui s'applique, et la première chambre civile de la Cour de cassation qui est compétente pour les pourvois.
Or dans le code de procédure civile, il y a un article 32-1, qui dispose ce qui suit :
Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 3 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Notre tunisien toulousain a donc fait appel, estimant que le JLD s'est trompé en rejetant la nullité qu'il avait soulevée. Le PPCA de Toulouse va rejeter son appel ,comme ça arrive presque à chaque fois, à Toulouse comme à Paris. Mais emporté par la fougue, le premier président va en outre estimé que son appel était « mal fondé, particulièrement dilatoire, abusif et processif (oui, c'est français)». Et de prononcer une amende civile de 300 euros à la charge de notre tunisien indésirable.
Si c'est vrai, c'est purement et simplement scandaleux.
Cet homme est privé de liberté. Il estime que la procédure qui a conduit à cette privation de liberté est illégale. Admettons, pour la discussion, qu'il se trompe, voire qu'il mente : il sait que la police lui a correctement notifié son droit à voir un avocat, d'ailleurs, il a eu cette entrevue. Peu importe pour son droit à agir. Il a le droit de soumettre cette prétention à un juge, qui la rejettera, et de faire appel de cette décision, pour qu'un juge plus élevé en expérience lui confirme que sa prétention ne tient pas. Ce n'est pas une lubie de ma part. C'est l'article 5§4 de la Convention européenne des droits de l'homme :
4. Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.
Qui se combine à merveille avec l'article 13 de la même convention :
Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles.
Or l'appel fait partie de ce droit à un recours effectif.
Comment peut-on oser dire qu'un homme qui conteste la privation de liberté dont il fait l'objet et demande à recouvrer celle-ci, qui est l'état naturel de l'homme, faut-il le rappeler, pourrait-il être abusif à le faire ?
Que son recours soit mal fondé, c'est au juge de le dire et d'en tirer la seule conséquence légale : le rejet de la prétention. L'article 32-1 du code de procédure civile ne prévoit pas d'amende pour une demande mal fondée : elle doit être dilatoire ou abusive. Et en l'espèce, elle ne peut être abusive, on l'a vu, sa nature s'y oppose. Quant à être dilatoire, c'est oublier que le recours devant le PPCA n'est pas suspensif : art. L. 552-10 du CESEDA. Comment un recours non suspensif pourrait-il être dilatoire, puisqu'il n'empêche pas la préfecture de procéder à l'éloignement ?
On voit qu'en droit, cette décision ne tient pas. Mais en plus, elle est révoltante : sanctionner celui qui dit « Libérez-moi ! » à celui qui en a le pouvoir, c'est une trahison de l'office du juge.
J'espère que j'ignore un point crucial de cette affaire, et que je me trompe. Sinon, je suis outré au-delà des mots.
Notes
[1] Je ne sais pas qui est l'auteur de cette décision. Je ne vise donc pas expressément le premier président Carrié Nunez : le premier président de la cour d'appel (PPCA) est une juridiction, généralement tenue par un conseiller délégué à cette fin. Il est compétent pour les appels des affaires de rétention des étrangers, et de référé détention, notamment. C'est cette juridiction que je désigne en parlant du premier président.
[2] Ce premier placement peut être fait en Local de Rétention (LRA), mais l'étranger ne peut y passer plus de 48 heures, ce local n'étant pas équipé de douches, par exemple, uniquement des couchettes et une salle commune.