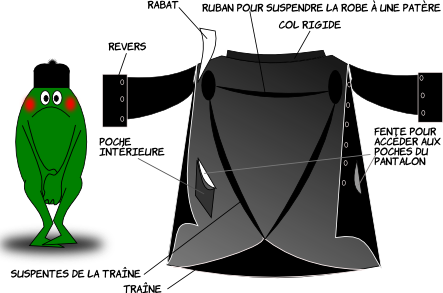Cher Samy,
Tu as choisi de t’exprimer sous pseudonyme pour exprimer ton malaise et critiquer durement le mouvement actuel de grève de l’aide juridictionnelle qui a conduit notre bâtonnier à suspendre les commissions d’avocats, notamment aux comparutions immédiates.
Dans une interview donnée au Plus de l’Observateur, tu écris cette phrase terrible : « Des personnes sont allées en prison à cause de leur avocat en grève », qui me laisse à penser que le choix du pseudonyme ne s’explique peut-être pas que par ta modestie.
Tu continues en expliquant que tu étais de permanence aux comparutions immédiates la semaine dernière et que, conformément aux consignes du Bâtonnier, les avocats présents ont systématiquement fait demander par leur client un délai, ce qui selon toi a abouti au placement en détention pour “la quasi totalité d’entre eux”, clients qui, s’ils avaient accepté d’être jugés le jour même, eussent peut-être été condamnés à des peines sans maintien en détention et fussent sortis libres, condamnés, mais libres. Et sans hésiter, tu jettes le blâme à la figure de tes confrères, “trop fiers (ou trop peureux) de voir leur client être jugé sans eux ou de désobéir à leur bâtonnier”. Cette expérience t’a visiblement éprouvée, puisque tu es rentré chez toi et que tu as eu “honte d’une profession corporatiste à l’extrême”, avant de réciter avec une docilité de séminariste la vulgate des éléments de langage du Gouvernement sur cette réforme, que visiblement, outre le Garde des Sceaux, toi seul a comprise et qui semble être la meilleure chose qui soit, et que nous refusons par aveuglement et veule soumission aux “cabinets d’affaire”, qui seraient naturellement à la manœuvre, comme à chaque fois qu’on parle d’aide juridictionnelle tant ça les concerne, probablement.
Samy, laisse-moi à présent donner quelques mots d’explications aux mékéskidis qui lisent ce blog, pour qu’ils comprennent bien ce que tu as voulu dire et en quoi tu as, de près comme de loin, en long en large et en travers, bref, fractalement tort.
La comparution immédiate est une procédure dérogatoire par laquelle le parquet décide de faire juger sans délai un prévenu dont il s’est assuré de la personne, soit en la faisant interpeller par la police, soit que la police l’ait interpellée de sa propre initiative dans le cadre d’une enquête de flagrance, ce qui est de loin l’hypothèse la plus fréquente. Typiquement, c’est la personne qui commet un délit mais se fait aussitôt ou presque attraper par la police, est placée en garde à vue, laps de temps pendant lequel la police parvient à réunir tous les éléments de preuve pour bâtir un dossier semblant assez solide au parquet pour être prêt à être jugé.
C’est une procédure dérogatoire car le droit commun est la convocation en justice, par huissier, ou remise en main propre contre signature par un procureur ou un officier de police judiciaire, ce qu’on appelle respectivement dans le jargon une citation directe, une convocation par procès verbal (CPPV) et une convocation par officier de police judiciaire (COPJ), le prévenu étant laissé libre, avec un délai minimum de dix jours, en pratique plusieurs semaines (à Paris, le parquet parvient à audiencer les COPJ sous six à huit semaines), pour préparer sa défense et notamment solliciter l’assistance d’un avocat. Ce temps, même bref, est précieux. Déjà le prévenu a le temps de se reposer et de s’alimenter correctement. Il n’arrive pas dans le prétoire en ayant (mal) dormi que quelques heures ces trois dernières journées, et en ayant mal mangé. Le repos et l’alimentation permettent d’avoir les idées claires. Ce que n’ont pas les prévenus en comparution immédiate. Ce laps de temps peut être mis à profit pour réunir des pièces justificatives de la situation professionnelle de l’intéressé, qui peut effectuer des démarches d’insertion ou de régularisation de sa situation, voire s’il reconnait les faits commencer à indemniser la victime. Sans compter que l’avocat a le temps d’effectuer des recherches poussées sur la jurisprudence et de décortiquer méticuleusement la procédure. Bref de faire son travail.
En comparution immédiate, l’avocat est la plupart du temps commis d’office (à Paris, 6 avocats sont désignés chaque jour pour défendre les prévenus en “compa”). Il découvre les dossiers (3 à 4 généralement) qu’il aura à traiter quelques heures (3 environ) avant l’audience, et doit les lire pour connaître les faits et rechercher les vices de procédure et moyens de droit à soulever, s’entretenir avec son client pour se présenter à lui, gagner sa confiance, mettre au point une stratégie de défense, qui commence souvent par le convaincre diplomatiquement de renoncer à son super-baratin-de-la-mort qu’il a potassé toute la nuit en cellule et qui à la lumière du manque de sommeil et de glycémie, lui paraît aussi génial qu’irréfutable, et lui expliquer comment se comporter à l’audience, en espérant qu’il se souviendra encore, une fois dans le prétoire d’un quart de ce qu’on lui aura dit.
Pris d’un bref moment de culpabilité, le législateur a posé certaines garanties procédurales pour le prévenu en comparution immédiate qui n’existent pas en droit commun. La première est que l’avocat est obligatoire. C’est le seul cas en matière pénale avec la CRPC, par exception au principe que plus l’avocat est nécessaire, moins il est obligatoire. Ah, j’entends des voix dans le fond qui disent qu’aux assises, l’avocat est obligatoire. Nenni. D’ailleurs, en 1851, Victor Hugo a plaidé aux assises pour son fils Charles, poursuivi pour outrage aux lois pour avoir protesté dans l’Événement contre une exécution. Avec peu de succès puisque son fils a mangé six mois de prison. Laissez faire les pros.
Autre garantie, le prévenu peut demander un délai pour être jugé. C’est de droit, le tribunal ne peut en aucun cas le refuser. Le prévenu doit même consentir à être jugé le jour même, “en la présence de son avocat” (art. 397 du CPP). Dans ce cas, les débats ne portent que sur le sort du prévenu en attendant la date de jugement, qui doit avoir lieu dans des délais minima et maxima fixés par la loi, mais qui ne dépassent pas 6 mois. Le prévenu peut être placé en détention provisoire jusque là, ou libéré sous contrôle judiciaire, voire remis en liberté purement et simplement, je l’ai déjà vu. Les critères sont ceux de droit commun, fixés à l’article 144 du CPP. Les plus couramment invoqués sont prévenir le renouvellement de l’infraction, si le prévenu est en état de récidive, a commis plusieurs faits ou a un casier chargé sans que la récidive ne soit constituée et l’absence de garanties de représentation, c’est à dire de certitude raisonnable que le prévenu se présentera de lui-même à l’audience ou pourra être convoqué pour exécuter la peine, ou si le casier judiciaire montre beaucoup de jugements “contradictoires à signifier” qui indiquent que le prévenu rechigne à se rendre librement aux convocations.
La défense peut demander des actes d’instruction au tribunal (art. 397-2), peut faire citer sans forme des témoins (art. 397-5 du CPP), c’est à dire sans les faire citer par huissier ni respecter de délai de comparution, et j’en profite pour attirer l’attention de mes confrères qui vont se frotter aux compas sur ce point : si dans la salle se trouve une personne désirant témoigner en la faveur du prévenu, le tribunal est tenu de l’entendre si vous dites “je la cite comme témoin”. Ne demandez JAMAIS au président d’user de son pouvoir discrétionnaire de l’art. 444 du CPP. Il peut refuser et le fera souvent aux compas. Invoquez l’art. 397-5, et il n’aura pas le choix.
Revenu de ce moment d’égarement, le législateur a armé le bras du tribunal avec une arme redoutable : aux comparution immédiates, le tribunal peut mettre immédiatement à exécution toute peine de prison ferme (on parle à tort de mandat de dépôt, c’est un maintien en détention) même si les conditions de droit commun pour ce faire ne sont pas remplies, à savoir un an ferme au moins, ou état de récidive légale.
Voilà, excuse cet aparté, Samy, mais ce vademecum était indispensable pour que nos lecteurs comprennent la suite.
Samy, à te lire, moi aussi, j’éprouve de la honte, mais pas pour les mêmes motifs. Si je te comprends bien, tu étais de permanence et tu as, toi aussi, demandé un délai pour tes clients qui visiblement sont partis au trou, faute de garanties de représentation selon toi (tu ne dis pas un mot sur le risque de réitération : tu n’avais que des primodélinquants avec un bail à leur nom, dans tes clients ?). Et tout cela hors la présence de membres du Conseil de l’Ordre, “laissant les jeunes avocats en première ligne”. Tu devais être distrait, tout à ta honte, car depuis des années, il y a deux avocats référents, des vieux briscards comme moi, qui chapeautent avec amour les jeunes confrères de permanence qui d’ordinaire sont plutôt enthousiastes à l’idée d’être en première ligne. Ils se sont présentés à toi, je n’en doute pas, ne serait-ce que pour s’assurer que tu serais à l’heure, et tu avais même leur numéro de mobile sur la fiche des box, à P12. Le Bâtonnier nous a demandé d’assurer nos permanences, et nous a même appris que nous avions renoncé à être rémunérés à cette fin, sans doute pour nous préparer à la réforme de l’aide juridictionnelle. Et si pour toi, c’est un membre du Conseil de l’Ordre ou rien, il y en a 4 qui assurent une permanence en cellule de crise, salle du Conseil, en face de la bibliothèque. Les portes sont toujours ouvertes. Il faut lire les e-mails du bâtonnier, Samy. On apprend des trucs, et ça évite d’écrire des âneries sur Le Plus.
Surtout, tu aurais pu lire dans la feuille de route de la grève la dernière phrase. Si tu es avocat, tu dois savoir que plus on approche de la fin d’un texte, plus il faut être vigilant, n’est-ce pas ? Je te la recopie ici : “Il faut enfin rappeler que cette grève a pour limite la clause de conscience de chacun et que les avocats qui estiment ne pas pouvoir respecter ce mouvement en raison des intérêts de leur client pourront y déroger. “
Eh oui, Samy, il est dit expressément que si tu estimais que l’intérêt supérieur de ton client l’exigeait, tu pouvais passer outre et plaider, sans désobéir à notre bâtonnier bien-aimé. Nul ne te l’aurait reproché. Mais tu ne l’as pas fait. D’après toi, seule la fierté ou la peur conduisaient tes confrères de permanence avec toi à se comporter ainsi. Vu la honte que tu expliques avoir éprouvée, on doit écarter la fierté comme motivation. Que reste-t-il ? Ta honte, est-ce vraiment à l’égard de la profession que tu la ressens, ou est-ce à l’égard de ta lâcheté ?
Mais permets-moi de te consoler, Samy. Tu fais preuve de l’arrogance de la jeunesse quand tu laisses entendre que les prévenus qui auraient été défendus au fond eussent échappé à la prison. Tu as déjà eu des permanences aux compas. Tu en as vu beaucoup sortir libres, quand je ne suis pas de permanence s’entend ? Et crois-tu vraiment que les procureurs de P12 requièrent des mandats de dépôt comme des robots, même face à des dossiers où un SME semble évident ? Accorde-leur le droit d’avoir une conscience, eux aussi, laisse-en un peu pour les autres.
Tu dis toi-même que “la quasi-totalité” des prévenus sont partis en prison. Donc certains sont malgré tout sortis libres. CQFD.
Comment diable fais-tu pour savoir lesquels parmi ceux partis en détention auraient, au seul vu du dossier, eu un sursis simple ou avec mise à l’épreuve, et lesquels n’auraient pu échapper au maintien en détention ? Car moi qui ai 15 ans de barre, et même des confrères beaucoup beaucoup beaucoup plus vieux comme Maître Mô (Joyeux anniversaire confrère) n’y parvenons toujours pas. D’ailleurs, Anne Portmann, journaliste à Dalloz Actualité, est allée voir une audience à la 23e/1 depuis que les avocats ne se présentent même plus. Les dossiers sont pris au fond, sans avocat. Regarde combien de sursis mise à l’épreuve sont prononcés. Et va jeter un œil au greffe aux feuilletons des jours précédents la grève. Regarde les peines prononcées habituellement. Compte les maintiens en détention.
D’ailleurs, tu as l’opprobre et la dénonciation faciles à l’égard de tes confrères (moi qui croyais qu’on était une profession corporatiste à l’extrême ?). Tu ressens de la honte à l’égard de ta profession, dis-tu ? Dis-moi, ne sont-ce pas ces présidents qui devraient mourir de honte de prendre les dossiers au fond quand la loi exige la présence d’un avocat pour les juger ? Ne devraient ils pas être plus rouges que la robe d’un premier président quand ils recueillent le consentement du prévenu à être jugé séance tenante hors la présence de l’avocat, en violation de la loi, ce qui est amusant quand on se souvient que ce qu’on reproche au prévenu, c’est… d’avoir violé la loi ? Où est ton indignation à géométrie variable ? Comment acceptes-tu sans dire un mot que les tribunaux invoquent des circonstances insurmontables alors que rien, strictement rien ne les empêche de renvoyer d’office à une date ultérieure, les délais légaux pour juger l’affaire n’arrivant pas à terme ?
Et pour ta péroraison, tu nous fais une reprise servile de la comm’ du Gouvernement. Tu as oublié ton esprit critique au vestiaire, Samy. Alors mettons les choses au point.
Le prélèvement “exceptionnel”, tu sais, un impôt exceptionnel comme l’est la CRDS, qui sera supprimée aussitôt la dette sociale remboursée, comme l’a été la vignette auto, qui a été exceptionnellement reconduite 46 ans durant, l’est sur les produits financiers des CARPA (prononcer le mot financier avec une moue de dégoût comme dans “mon ennemie c’est la finance”). Les CARPA (CAisses des Règlements Pécuniaires des Avocats) sont des comptes bancaires (un par Ordre) où sont déposés tous les fonds reçus par les avocats destinés à des tiers. Il nous est interdit de les déposer sur nos comptes, pour garantir leur représentation et prévenir le blanchiment. Ces caisses sont gérés par les ordres, à leurs frais (à Paris, c’est plusieurs salariés à plein temps), où chaque mouvement est vérifié et tracé. C’est sur ce compte que l’État verse les fonds de l’aide juridictionnelle destinés à chaque ordre. Il a toujours été convenu que ces fonds pouvaient être placés, SANS RISQUE pour des motifs évidents (donc parler de boursicotage est malhonnête, Samy, et être malhonnête sous pseudo, c’est mal), et que ces produits financiers étaient acquis à l’Ordre, pour financer la gestion de la CARPA et de l’aide juridictionnelle, puisque l’État se décharge sur l’Ordre de cette tâche et qu’on a des salariés à plein temps sur ce boulot, mais aussi notre formation continue obligatoire (pourquoi les formations sont-elles gratuites à Paris, Samy, à ton avis ?) et d’autres actions de solidarité et de prévoyance (notamment le congé maternité pour les collaboratrices, mais tu t’en fous, t’es un mec). Et je ne sais pas si tu fais du fiscal, mais tu crois que les produits financiers ne sont pas déjà imposés ? Tu as entendu parler de la CSG, de la CRDS, et du prélèvement libératoire ? Programme de L2, Samy, et tu y étais il y a moins longtemps que moi. L’État prélève déjà, et plus que 15 millions par an.
Et Samy, franchement, tu n’as pas honte quand tu écris “Honte d’une profession qui fait croire à ses confrères que l’indemnité de garde à vue sera diminuée de moitié alors que cette disposition réglementaire n’est pas présente dans le projet de loi de finances.” Samy, sérieux, tu t’étonnes qu’une disposition réglementaire ne soit pas dans une loi de finance ? Je veux dire, à part le fait que ce serait contraire à la Constitution ? Rappelons à nos lecteurs, Samy, que les dispositions réglementaires relèvent du décret, donc du gouvernement, contrairement à la loi qui relève du parlement, que la Constitution répartit le domaine de chacun et interdit tout empiètement. Le projet de barème, qui relève d’un simple arrêté ministériel, a été communiqué à l’Ordre, et a été publié sur Dalloz Actualité. Regarde le tableau “Ajustements”.
La Chancellerie trompette partout qu’elle va réévaluer l’Unité de Valeur, ce qui est faux, puisqu’elle dit que la nouvelle UV nationale “sera supérieure à sa moyenne nationale actuelle”. Donc qu’elle va baisser dans certains barreaux, les plus petits. Mais oui, à Paris, elle va un peu augmenter (d’un euro et demi). Elle oublie de dire que le coefficient par lequel on multiplie l’UV pour calculer l’indemnisation de l’avocat va être sacrément revu à la baisse, notamment pour la garde à vue (où on passe de 12,40 à 7,5) ou pour les référés au tribunal d’instance (de 16 à 6). Pour pouvoir affirmer que c’est un ajustement, on augmente les UV pour l’audition libre de 3,64 à 4 (soit +0,36 UV), pour le délégué du procureur de 1,9 à 2 (+0,1 UV), ou devant la chambre des appels correctionnels de 8 à 9 UV. C’est à dire qu’on a 19 baisses jusqu’à 10 UV, tandis que la plus grande des 7 hausses est de +1,46 UV. Bref, la rémunération va globalement diminuer, et pas qu’un peu. Parfois de plus de moitié.
Alors pourquoi claironner que le budget augmente ? Parce que le relèvement des plafonds de l’aide juridictionnelle, déjà fort hauts (1393 euros mensuels pour une personne seule) va rendre éligibles 100 000 personnes de plus. C’est à dire que l’État offre à 100 000 personnes qui avaient les moyens de payer un avocat un accès gratuit à la justice, et ce en indemnisant moins l’avocat. C’est un cadeau électoral fait sur notre dos et qu’on nous demande de financer par-dessus le marché, car il n’y a pas de repas gratuit, Samy. Ces fonds que tu présentes comme tombés du ciel, ils manqueront. L’Ordre devra pour équilibrer ses comptes, renoncer à la gratuité des formations, augmenter les cotisations, ou renoncer à la prise en charge des congés maternité des collaboratrices. Et nous devrons accepter de défendre des clients à l’AJ encore plus à perte, ou pour les cabinets exerçant dans des secteurs à forte pauvreté (Balbyniens RPZ) de compenser par le volume en prenant encore plus de dossiers et en les traitant plus superficiellement. Tiens, comme le système de Public Defender en vigueur dans bien des États aux USA. Ça fait envie.
Que tu gobes avec une telle naïveté la comm’ du Gouvernement et mettes la colère profonde et réelle qui agite ta profession sur le seul compte du soi-disant corporatisme extrême de la profession (que je t’invite à découvrir en défendant des confrères au disciplinaire, tu vas voir) au point de te retourner contre elle (car on est tous des cons sauf toi) ne laisse pas de m’inquiéter. Pas pour toi, mais pour tes clients.
Samy, c’est bien d’écouter son cœur, à condition de ne pas oublier d’écouter aussi sa tête.


 Il a défendu des journalistes, comme Anna Politovskaia, les familles des victimes de la prise d'otage du théâtre de Moscou, et s'était illustré au début de sa carrière en défendant la famille d'une jeune fille Tchétchène, Elza Koungaïeva, morte à 18 ans, étranglée par un colonel de l'armée russe, Iouri Boudanov, après qu'il l'ait enlevée, battue et violée.
Il a défendu des journalistes, comme Anna Politovskaia, les familles des victimes de la prise d'otage du théâtre de Moscou, et s'était illustré au début de sa carrière en défendant la famille d'une jeune fille Tchétchène, Elza Koungaïeva, morte à 18 ans, étranglée par un colonel de l'armée russe, Iouri Boudanov, après qu'il l'ait enlevée, battue et violée.