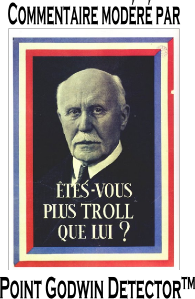Le Gouvernement a donc décidé, pour des motifs d’opportunité politique assez évidents sur lesquels je ne m’étendrai pas, ayant assez de choses à dire par ailleurs, de mettre en œuvre une politique d’expulsion, au sens premier du terme : « pousser dehors », les Roms étrangers vivant en France.
Ils sont fous, ces Roms, hein ?
Avant d’aller plus loin, qu’est-ce qu’un Rom ? Rom vient du mot Rrom, en langue romani (l’orthographe a été amputé d’une lettre en français, la double consonne initiale n’existant pas dans cette langue), qui signifie « homme » au sens d’être humain (féminin : Roma ; pluriel : Romané). Il s’agit d’un peuple parti, semble-t-il (la transmission de la culture étant orale chez les Roms, il n’existe pas de source historique fiable, mais tant la langue romani parlée par les Roms que la génétique confirme l’origine géographique indienne), du Nord de l’Inde (Région du Sindh, dans l’actuel Pakistan, et du Penjab pakistanais et indien) aux alentours de l’an 1000 après Jésus-Christ, sans doute pour fuir la société brahmanique de l’Inde qui les rejetait comme intouchables (c’est donc une vieille tradition pour eux que d’être regardés de travers par leur voisin).
Ils sont arrivés en Europe via la Turquie au XIVe siècle, suivant les invasions des Tatars et de Tamerlan, et s’installèrent dans l’Empire byzantin (qui les appelle Ατσίγγανος , Atsinganos, « non touchés », du nom d’une secte pré-islamique disparue, dont les zélotes refusaient le contact physique ; quand les Roms arrivèrent, les byzantins, qu’on a connu plus rigoureux dans leur réflexion, les prirent pour des membres de cette secte), ce qui donnera tsigane, Zigeuner en allemand et Zingaro en italien. Ceci explique que leur foyer historique se situe dans les actuelles Turquie, Roumanie, Bulgarie, pays qui restent les trois principales populations de Roms, et dans les Balkans (ex-Yougoslavie).
Outre des professions liées au spectacle ambulant, les Roms se sont spécialisés dans des professions comme ferronniers et chaudronniers, Γύφτοs, Gyftos, ce qui donnera Gypsies en anglais, Gitano en espagnol, et Gitan et Égyptien en Français (dans Notre Dame de Paris, la Recluse appelle Esmeralda « Égyptienne » ; et Scapin appelle Zerbinette « crue d’Égypte »).
Le roi de Bohême (actuelle république Tchèque) leur accordera au XVe siècle un passeport facilitant leur circulation en Europe, d’où leur nom de Bohémiens. De même, le Pape leur accordera sa protection (Benoît XVI est donc une fois de plus un grand conservateur) Leur arrivée en France est attestée à Paris en 1427 par le Journal d’un Bourgeois de Paris (qui leur fit très bon accueil) — C’est d’ailleurs à cette époque que se situe l’action du roman d’Hugo Notre Dame de Paris.
Pour en finir avec les différents noms qu’on leur donne, Romanichel vient du romani Romani Çel, « groupe d’hommes », Manouche semble venir du sanskrit manusha, « homme », soit le mot Rrom en romani, et Sinti semble venir du mot Sind, la rivière qui a donné son nom à la province du Sindh dont sont originaires les Roms. Sinti et Manouche désignent la même population rom établie dans les pays germanophones et presque intégralement exterminés lors de la Seconde guerre mondiale C’est pourquoi le mot Tsigane, évoquant l’allemand Zigeuner, d’où le Z tatoué sur les prisonniers roms, est considéré comme blessant aujourd’hui .
Il convient ici de rappeler que les Roms ont été, aux côtés des Juifs, les cibles prioritaires de la politique d’extermination nazie. Le nombre de victimes du génocide, que les Roms appellent Samudaripen (« meurtre collectif total »), se situe aux alentours de 500 000, avec pour les Sinti allemands entre 90 et 95% de morts.
Ces mots peuvent être utilisés indifféremment pour désigner les Roms, encore que les siècles d’installation dans des pays différents ont fait apparaître des différences culturelles profondes. Même la langue romani n’est plus un dénominateur commun, puisque les Roms d’Espagne et du sud de la France, les Gitans, parlent le kalo, un sabir mâtiné d’espagnol, depuis qu’une loi espagnole punissait de la mutilation de la langue le fait de parler romani (les espagnols ont un atavisme profond avec les langues, mais c’est un autre sujet).
En 1971 s’est tenu à Londres le Congrès de l’Union Rom Internationale (IRU) qui a adopté le terme de « Rom » pour désigner toutes les populations du peuple rom, d’où l’usage de ce terme dans ce billet (ce que les gitans refusent, eux se disent kalé). Le mot rom ne vient donc absolument pas de Roumanie, ni de Rome, bien que ce peuple se soit installé en Roumanie et auparavant dans l’Empire romain d’Orient.
Je ne puis conclure ce paragraphe sans vous inviter à lire les commentaires de cet article, où je ne doute pas que des lecteurs plus érudits que moi apporteront de précieuses précisions ou, le cas échéant, rectifications.
Tous les chemins mènent aux Roms
Les Gens du voyage sont-ils des Roms ? En un mot, non. Le nomadisme n’est pas une tradition chez les Roms, mais une nécessité historique. Aujourd’hui , entre 2 et 4% des Roms sont du voyage, c’est-à-dire ont fait le choix d’une vie nomade. Et beaucoup de gens du voyage ne sont pas roms, comme les Yéniches, que l’on prend souvent pour des Roms. Les forains sont aussi nomades, mais du fait de leur profession, et pour la plupart ne sont pas Roms. Et si demain, il vous prenait la fantaisie de vivre une vie nomade, vous deviendriez aussitôt Gens du Voyage, sans pour autant devenir Rom (sauf aux yeux des lecteurs du Figaro). Un abus de langage est apparu du fait que la Constitution française interdit toute distinction sur une base ethnique. Le terme de Gens du Voyage, neutre de ce point de vue, est souvent employé aux lieu et place du mot Rom. Or ce ne sont pas des synonymes.
Ce qui d’emblée montre que le problème des occupations illégales de terrains, publics ou privés, par des Roms ne vient pas uniquement du fait que la loi Besson (pas Éric, non, celui qui est resté de gauche, Louis) du 5 juillet 2000, qui oblige les communes de plus de 5000 habitants à prévoir des aires d’accueil, est allègrement ignorée par la majorité des maires.
Quand un Rom viole la loi, c’est mal. Quand l’État viole la loi, c’est la France. Laissez tomber, c’est de l’identité nationale, vous ne pouvez pas comprendre.
La majorité des Roms en France sont Français, et leur famille l’est même depuis plusieurs siècles. Les Roms ont de tout temps adopté le style de vie des pays où ils se sont installés, jusqu’à la religion (ils sont catholiques en France, protestants en Allemagne, musulmans en Turquie et dans les Balkans), et il ne viendrait pas à l’idée d’un Rom de donner à ses enfants un prénom qui ne soit pas du pays où il nait (lire les prénoms des enfants d’une famille rom permet parfois de retracer leur pérégrination ; exemple : Dragan, Mikos, Giuseppe, Jean-Pierre). Cela ne les empêche pas de garder vivace la tradition rom, à commencer par la langue romani, et l’importance primordiale de la famille élargie (la solidarité n’est pas un vain mot chez les Roms). Il est d’ailleurs parfaitement possible qu’un de vos collègues de travail soit Rom et que vous ne l’ayez jamais soupçonné.
Naturellement, ces Roms ne sont pas personnellement menacés par la politique actuelle, même s’il est probable qu’ils la vivent assez mal.
Les Roms étrangers sont donc quant à eux des migrants qui veulent une maison qui ne bouge pas, et habitent des habitations de fortune, triste résurgence des bidonvilles. Ils viennent de pays qui ont toujours refusé l’intégration des Roms, en faisant des parias dans leur propre pays. Même si l’intégration à l’UE de ces pays a conduit à un changement total de politique, les états d’esprit, eux n’ont pas changé, et le rejet répond hélas souvent au rejet. Certains Roms se sont sédentarisés et tant bien que mal intégrés, comme les Kalderashs (du roumain Căldăraşi, chaudronniers, habiles travailleurs du métal, en particulier du cuivre) ; d’autres, comme les nomades, forment une société fermée et hostile aux gadjé — aux non-Roms. La plupart des Roms de Roumanie qui viennent en France sont des kalderashs, et non des nomades, fuyant la misère et le rejet dont ils font l’objet dans leur pays. Donc, pas des gens du voyage.
Les roms des Balkans (ils sont nombreux en Serbie et au Kosovo) fuient eux aussi la misère, même si certains demandent l’asile (très peu l’obtiennent) prétendant faire l’objet de persécutions. Il faut reconnaître que lors de la guerre du Kosovo en 1999, des Roms ont été recrutés par les troupes serbes pour se livrer à des opérations militaires de nature à intéresser le tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (TPIY), et se sont acquittés de cette tâche avec un zèle qui n’a pas laissé de très bons souvenirs auprès des populations kosovares (j’entends par là : albanais du Kosovo).
Des Roms, des stats et de la bière nom de Dieu
Une question se pose, et je ne tiens pas à l’éluder : celle des Roms et de la délinquance. Le lien est certain, les chiffres ne mentent pas. Partout en Europe, les Roms sont bien plus victimes de la délinquance que les autres populations. Destructions de biens, agressions racistes, sur lesquelles les autorités ferment bien volontiers les yeux, d’autant plus que les Roms, on se demande pourquoi, ont développé à leur encontre une certaine méfiance, quand ce ne sont pas des pogroms. Sans compter les crimes contre l’humanité subis par ce peuple, que ce soit le génocide nazi ou la réduction en esclavage en Valachie et en Moldavie —oui, des esclaves en Europe— jusqu’à la seconde moitié du XIXe siècle.
Ce n’est pas une boutade, c’est une réalité : la délinquance, les Roms en sont d’abord victimes. On a déjà vu que même en France, État de droit imparfait mais État de droit, l’État ne respecte pas la loi Besson. Vous verrez dans la suite de ce billet qu’au moment où je vous parle, il fait encore pire à leur encontre puisque la politique d’expulsion mise en œuvre est illégale. Ce n’est pas moi qui le dis, ce sont les juges administratifs. L’Union européenne l’a remarqué. Le Conseil de l’Europe l’a remarqué. L’ONU l’a remarqué. Le Pape l’a remarqué. L’UMP n’a rien remarqué.
Mais n’esquivons pas la question de la délinquance de Roms. De Roms, pas DES Roms. Elle existe, c’est indéniable, ne serait-ce du fait qu’aucun groupe humain n’est épargné. Est-elle plus élevée que dans les autres groupes sociaux ? C’est probable.
Évacuons rapidement une question sur laquelle je reviendrai dans le prochain billet : l’occupation sans droit ni titres de terrains publics ou privés. Il ne s’agit pas de délinquance, puisqu’au pire (occupation d’un terrain public), ces faits sont punis d’une contravention de grande voirie.
Les causes premières de la délinquance, au-delà du mécanisme intime et personnel du passage à l’acte, qui fonde la personnalisation de la peine, sont la pauvreté (liée au chômage ou à la précarité de l’emploi ; un CDD est aussi rare dans une audience correctionnelle que la vérité dans la bouche d’Éric Besson), l’exclusion (qu’entraîne mécaniquement le fait d’être sans-papier, notamment), le faible niveau d’instruction (qui empêche d’accéder aux professions rémunératrices), outre le fait que la délinquance concerne surtout des populations jeunes (le premier enfant a un effet remarquable sur la récidive).
Vous avez remarqué ? Je ne viens pas de vous dresser un portrait du jeune versaillais. Plutôt celui du jeune Rom des terrains vagues. Ou du jeune des cités, soit dit en passant pour la prochaine fois ou on tapera sur eux. À vous de voir avec votre conscience si vous voulez y ajouter une composante génétique.
Parce qu’aucune statistique n’existe sur la délinquance des Roms. Aucune. Tout simplement parce que ce serait interdit : Rom est une origine ethnique, or la loi prohibe la constitution de fichier sur des bases ethniques ou raciales — suite à un précédent quelque peu fâcheux.
Donc quand le ministre de l’intérieur Brice Hortefeux, que l’on a connu plus méticuleux en matière d’arithmétique ethnique, prétend présenter des statistiques de la délinquance des Roms pour justifier la politique du Gouvernement, il ment. Je sais, ça devient une tradition de ce Gouvernement, mais que voulez-vous, je n’arrive pas à m’y faire. Quelqu’un, je ne sais plus qui, m’a mis dans la tête l’idée saugrenue de République exemplaire, du coup, je fais un blocage.
Le ministre de l’intérieur a cru devoir présenter publiquement (sur RTL) le 25 août des statistiques fondées sur « une étude des services de police », non sur l’origine ethnique, interdite, mais sur la nationalité du délinquant, roumaine en l’occurrence.
Mes lecteurs ayant suivi jusqu’ici ont déjà compris l’inanité de l’affirmation. Rom ne veut pas dire Roumain, et le ministre joue ici sur la ressemblance des termes, et l’inculture de son auditoire. Mes lecteurs sachant faire la différence entre un mot sanskrit et un mot latin, je ne m’attarderai pas sur ce stratagème grossier, qui ne trompera que qui veut être trompé.
De plus, les services de police, même si on leur fait perdre un temps précieux depuis des années à collectionner des statistiques inutiles hormis à la communication gouvernementale, ne sont pas un service de statistique. La méthode de récolement des données n’a rien de scientifique et n’a jamais eu la prétention de l’être. Elle repose sur les délits constatés ou dénoncés, ayant donné lieu à élucidation. Donc préalablement à enquête. Or la distribution des effectifs et des moyens (limités, et de plus en plus du fait de ce même Gouvernement) dépend pour l’essentiel des directives données par ce même Gouvernement.
Je m’explique. Le Gouvernement estime que l’opinion publique, qu’il confond hélas trop volontiers avec le peuple souverain, est particulièrement remontée contre les vols à la tire (les pickpockets) ou à l’arraché (qui en est une variante un peu plus bourrin) dans les transports en commun. Le ministre de l’intérieur va demander aux forces de police de mettre la pression contre cette délinquance. Le commissaire de police va recevoir cette instruction et va redistribuer ses effectifs, qui préalablement luttaient contre les violences faites aux personnes, sur les voleurs du métro. Mécaniquement, le nombre d’interpellation pour des faits de violence va baisser. Les policiers interviendront toujours lors d’une bagarre, mais n’arrêteront personne pour des faits de violences légères, puisque leur mission est de surveiller les voleurs à la tire. Un délit constaté de moins = baisse de la statistique correspondante, sans que la réalité n’ait changé en quoi que ce soit. En revanche, plus de voleurs à la tire seront arrêtés (car la police reste malgré tout plutôt efficace dans son boulot). Augmentation de la statistique, sans lien avec l’évolution de la réalité. Voilà la méthodologie qui préside à la confection de ces statistiques.
C’est pourquoi le ministre peut proclamer des chiffres aussi aberrants, et sans hélas faire tiquer qui que ce soit, qu’une augmentation de 138% en un an de la délinquance roumaine. Personne ne fait le lien avec une autre donnée, qui indique que 13,65% des auteurs de ces vols seraient Roumains (sous-entendu : Roms). C’est-à-dire que 13,65% des délinquants sont responsables d’une augmentation de 138% des délits. Qui a dit que les Roms étaient des feignants ?
D’autant plus que pour fréquenter un peu les prétoires parisiens, je suis assez bien placé pour savoir qu’il existe aussi une délinquance roumaine non-rom, assez active ces derniers mois, dite de l’escroquerie aux « Yes-card ». Une Yes-card est une fausse carte de crédit qui, quel que soit le code que vous tapez, renvoie toujours une réponse positive au lecteur, faisant croire que la banque a accepté la transaction. Des Roumains achètent ainsi des vêtements de marque et des parfums, et vont les revendre à Bucarest. C’est une atteinte aux biens, commise par des Roumains, mais pas par des Roms. Sauf dans les statistiques de M. Hortefeux.
Brisons là, ce billet mérite je pense d’être soumis à vos commentaires. Le deuxième volet sera centré sur le droit des étrangers et portera sur les mesures actuelles d’expulsion, pour lesquelles le Gouvernement use selon les cas de deux méthodes : soit violer la loi, soit se payer votre tête.
Et fort cher, si ça peut vous consoler.